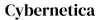Alors que le monde politique s’agite autour de la nomination du nouveau gouvernement et, avec lui, d’une nouvelle ministre du numérique un paradoxe devient impossible à ignorer.
Plus on parle du numérique et de ses problèmes, moins on agit concrètement.
Prenons la souveraineté numérique. Désormais, tout le monde s’accorde à dire que c’est un enjeu majeur. Même le cabinet Asteres, pourtant réputé proche des grandes plateformes, l’affirme dans une étude commandée par le Cigref : nos dépendances aux big tech nous coûtent trop cher. Il serait urgent de changer de modèle.
Depuis que VMware, la société qui motorise le cloud avec ses outils de virtualisation, a fait flamber le prix de ses licences, de grandes entreprises françaises découvrent avec effroi qu’elles n’ont pas forcément les budgets pour suivre.
Comme nous l’avons souvent écrit, ce n’est que face au mur que l’on voit vraiment le mur.
Ce qui vaut pour la souveraineté vaut aussi pour la cybersécurité. Lors de plusieurs conférences récentes, le patron de l’ANSSI a dressé un tableau apocalyptique des menaces qui nous attendent, sans la réserve habituelle de l’agence. Il faut dire que ces deux dernières années, la quasi-totalité des services en ligne ont été piratés et que l’ensemble des données des Français s’est retrouvé sur le dark web.
Comme pour la souveraineté, tout le monde sait ce qu’il faudrait faire et comment s’y prendre. Mais alors, si politiques, industriels et acteurs du numérique partagent le même constat, pourquoi rien n’avance ?
En réalité, si tout le monde est d’accord sur le diagnostic, surtout parce qu’il n’est plus possible de l’ignorer politiquement, personne ne s’accorde sur les solutions ni sur la rapidité avec laquelle les mettre en œuvre.
Passer de « il faudrait faire » à « voilà ce qu’on peut faire maintenant » reste difficile. Trop de monde a intérêt à entretenir un entre-deux et à prolonger l’inaction.
Depuis quelques années, la stratégie a consisté à écarter ceux qui portent des solutions concrètes et une vraie volonté de changement.
L’action mobilise des profils différents, comme on a pu le constater lors de la crise du Covid. Elle remet aussi en cause de nombreux pouvoirs acquis et des structures de financement bien installées.
Pourtant, il faudra bien passer d’un écosystème de problèmes à résoudre à un écosystème de solutions à mettre en œuvre.
Les exemples ne manquent pas. Quand on parle de dépendance numérique, plusieurs pistes existent :
- Changer les postes clients Windows de toute l’administration pour passer sur des postes Linux, comme l’ont fait la gendarmerie nationale ou l’armée de l’air.
- On pourrait imaginer une bascule en quelques années de la totalité des postes clients et mettre en place des stratégies de financement pour l’accompagner.
- Même pour le mobile, il existe deux alternatives à Android open source et totalement indépendantes de Google, qui pourraient permettre de créer de nouvelles flottes de terminaux libres de toute dépendance.
- On pourrait choisir une liste de logiciels de remplacement, en créant des quotas d’achats pour quelques centaines de millions d’euros par an de logiciels alternatifs de PME françaises.
- On peut également réfléchir à ce qu’il nous manque, proposer les logiciels adéquats, puis mettre en place un programme de financement pour les acteurs qui souhaitent les mettre en œuvre.
- On peut enfin envisager d’investir pour consolider les composants en logiciels libres, souvent essentiels au bon fonctionnement du système.
En Allemagne ou même en Hollande, des fondations s’en occupent. En France, ce système n’existe pas et les acteurs du logiciel libre sont obligés de naviguer dans la complexité des appels d’offres européens pour tenter de financer leur recherche et développement.
Cette transition est en réalité plus simple qu’on ne le pense.
Avec l’IA, il n’est plus nécessaire de consacrer du temps à recréer des copies conformes des outils d’hier : on peut directement inventer de nouveaux usages.
Même Microsoft le reconnaît désormais. Selon son propre patron, Excel et les outils classiques de bureautique sont dépassés par les nouveaux services de l’IA.
Pourquoi continuer à s’endetter pour financer ce qui appartient déjà au passé ?
L’une des premières mesures serait d’abandonner les formats propriétaires.
Avec l’arrivée de ChatGPT, nous sommes passés des fichiers Word à des formats plus simples comme le Markdown, qui facilitent l’édition des contenus.
Pourquoi ne pas généraliser ces formats dans toute l’administration ?
Il y a aussi la question de l’email. Depuis longtemps, nous aurions dû laisser ce service aux acteurs indépendants, nombreux et compétents en France, capables de l’opérer sur leurs propres serveurs.
Enfin, il aurait été possible d’imposer une directive pour que l’État n’utilise et n’investisse en communication que dans des réseaux sociaux sobres et fiables, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas connus pour propager la désinformation ou la manipulation.
Ce n’est peut-être pas très “fancy”, mais on n’attend pas du service public ou de ses agents qu’ils soient cool sur les réseaux, simplement qu’ils soient présents et efficaces.
Ce qui est frappant aujourd’hui, c’est que la souveraineté numérique ressemble de plus en plus au bio : la demande vient des utilisateurs eux-mêmes, et les décideurs politiques, dépassés par cet engouement, commencent à sentir le risque de ne rien faire.
Même s’il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, le retour de Polytechnique sur sa décision de passer à Microsoft, ou encore le remplacement de la directrice du Health Data Hub — après avoir pris le risque d’héberger la plateforme chez Microsoft et plusieurs années de rebondissements — montrent que les lignes commencent à bouger.
Je dis « semble » car se contenter d’utiliser des outils indépendants pour reproduire l’existant serait une occasion manquée.
Je n’ai jamais cru à la centralisation des stratégies numériques. Ce qui compte aujourd’hui, c’est de bâtir une vision commune, où l’humain retrouve toute sa place au cœur du système.
Pendant des années, un habile storytelling a permis de faire passer le statu quo pour une modernisation. Mais ce cycle touche à sa fin.
L’IA est une révolution tellement importante et dont les impacts sont tellement imprévisibles qu’il faut se préparer.
Dans le monde d’aujourd’hui, n’importe quel Français peut télécharger les documents du gouvernement, le budget de sa région ou de sa ville, les faire analyser par l’IA et poser ensuite des questions ultra précises.
Les mêmes outils permettent aux citoyens de savoir comment remplir les formulaires de la vie courante, et d’atteindre, le temps d’une session, le niveau de compétence d’un fonctionnaire expérimenté. Évidemment, l’IA n’a pas toujours la réponse parfaite, mais pour beaucoup de Français, les services qu’ils utilisent quotidiennement vont commencer à montrer leurs limites.
L’ère du citoyen augmenté suppose des services publics de haut niveau, mais aussi des fonctionnaires augmentés, capables de disposer de la latitude nécessaire pour opérer à la vitesse nouvelle qu’on attend désormais d’eux.
Or, ce que l’on constate, c’est que l’administration reste bloquée dans les années 2010, celles des GAFAM « gentils » et du Web 2.0, où les stratégies de données ouvertes et la bienveillance numérique pouvaient encore se vendre au citoyen.
Ça, c’était avant que l’IA avale notre gouvernement numérique de manière indiscriminée pour créer des modèles de données qui espèrent les remplacer.
Alors que tous les politiques ont les yeux rivés sur 2027, peu ont compris que le niveau de compétence des citoyens va exploser, boostés à l’IA, ils vont apprendre à vitesse accélérée et avec un niveau d’exigence qui n’a jamais été demandé auparavant.
Toute une génération d’acteurs publics qui n’a pas compris les enjeux de l’IA, c’est-à-dire qu’une inversion du pouvoir au service des citoyens, bien plus agiles, plus informés et plus exigeants grâce à l’IA, a déjà commencé.
Et hélas, beaucoup restent convaincus qu’il suffit de parler d’un futur souverain que tout le monde souhaite, mais qu’ils ne savent pas délivrer, ce qui masque aussi leur impuissance à imaginer ce qui arrive après.
S’ils savaient.
Pour les abonnés payants, je partage ma veille quotidienne sur une channel privée qui vous est réservé, pour y accéder voici le lien.
Lire l'article complet
S'inscrire maintenant pour lire l'article complet et accéder à tous les articles déstinés aux payants abonnés.
S'abonner