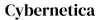Je voulais revenir sur la polémique autour de Luc Julia. Elle me rappelle la règle des trois L (lécher, lâcher, lyncher) qui s’appliquent peu ou prou à toute personne médiatique en France.
Pour ma part, je n’ai pas grand-chose à reprocher à Luc Julia. Il a toujours été très sympa et nous avons des références technologiques communes, ce qui me permet de comprendre en partie son état d’esprit, avec son humour noir et son regard désabusé sur la tech d’aujourd’hui.
Le dispositif médiatique parisien fonctionne comme toujours, sans surprise. Les maisons d’édition ont besoin de créer des bios dithyrambiques et la presse, comme les politiques, cherchent leurs “bons clients” selon l’actualité. Il est arrivé au bon moment et avec le bon positionnement, car ses conférences alimentent l’idée que l’IA produite par la Silicon Valley d’aujourd’hui n’est pas la perfection technologique que l’on nous vend. C’est un discours qui rassure les politiques et la presse.
Pour ma part, j’ai toujours défendu une vision singulière à savoir l’idée qu’on peut créer en France des produits et des logiciels avec la même excellence que la Silicon Valley, même si c’est difficile. Une idée plus difficile à vendre mais nous l’avons fait deux fois (Netvibes et Jolicloud).
Une redescente difficile
Mais au-delà de la polémique stérile, ce qui ressort de cette histoire, c’est que ceux qui ont vécu la Silicon Valley des années 90 ont connu ce qui fut probablement le summum de l’expérience informatique.
Les années 70, c’étaient les pionniers qui faisaient sortir l’informatique des mainframes, symbolisés par des bidouilleurs de génie qui alliaient microprogrammation, microinformatique et microprocesseur, et pour qui la bidouille semi-industrielle a toujours été une marque importante du succès dans l’informatique. (Cette façon de réfléchir est devenue le modèle mental des hackers.)
Les années 80 ont industrialisé ces idées : le software qui a fait la fortune de Microsoft et l’UX d’Apple dont le Mac est inspiré des travaux du Xerox PARC, lui-même une continuation du Stanford Research Institute.
Les années 90 étaient différentes : pour la première fois, on commençait à voir de très grandes entreprises de la tech où il fait bon vivre et qui travaillaient avec une vision relativement humaniste de la technologie.
On était loin des dark patterns et de toutes les manipulations pour forcer l’hypercroissance. On était aussi loin des trillion dollar companies et de leur mentalité.
Les années 90, c’était l’époque où l’on essayait de vendre des dizaines de millions, peut-être une centaine de millions de produits, mais pas des milliards. Produire pour un milliard d'utilisateurs impose une standardisation et un appauvrissement : un McDonald’s de la pensée et de l’information, comme les grandes plateformes actuelles.
Il y avait une dizaine de ces entreprises avec cette vision. Moi, j’avais atterri chez Sun Microsystems en 1995 à Mountain View, au moment du lancement de Java, de la télévision interactive et des network computers.
Une chose est sûre, quand on a vécu cette époque, on veut la prolonger. Mais elle laisse aussi une profonde désillusion vis-à-vis de la génération technologique actuelle, focalisée essentiellement sur le pouvoir par le monopole.
Comme moi, Luc dégage souvent dans ses présentations ce parfum du “c’était mieux avant”.
Ce n’est pas un regret naïf : à l’époque, l’informatique se construisait pour des humains, pas pour des infrastructures globales sans âme. Google dans les années 90, c’était le “Do no evil”, une organisation du savoir façon bibliothèque d’Alexandrie (je me rappelle les nombreuses conversations que j’ai eues avec Larry Page sur l’IA et la science-fiction). Tout cela n’a plus rien à voir avec le Google d’aujourd’hui, façonné par l’optimisation SEO, la domination des marchés et l’obsession des revenus publicitaires.
J’ai toujours cru que la bascule a eu lieu après le 11 septembre 2001. Avant, on parlait d’interdire ou de limiter strictement les cookies pour protéger la vie privée. L’internet serait un environnement technique où la protection de la vie privée serait totale.
Après la chute des tours, tout a été balayé : big data, surveillance, destruction des protections légales. Le rêve de liberté est mort à ce moment-là. Nous sommes entrés dans ce que Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance, basé sur l’absence de vie privée et l’intégration d’outils intrusifs au cœur de notre intimité.
En quelques années le modèle de pensée de la NSA, c’est-à-dire l’analyse extensive des données et la collecte intégrale pour générer des analyses de comportements, est devenu le business model central. Et l’Europe avec ses données et ses utilisateurs une nouvelle proie.
Mon parcours suit une ligne proche de celle de Luc Julia, à une exception près : j’ai quitté la France avant de démarrer ma thèse en IA (même école), parce que mon professeur jugeait ce secteur sans avenir et voulait m’obliger à faire du traitement du signal. En même temps, j’avais compris que le Web serait la technologie la plus importante de l’histoire et que c’était maintenant ou jamais de se lancer dans l’aventure.
Dans les années 90, pour un informaticien français, l’avenir était aux États-Unis. En France, l’Internet était verrouillé par les opérations des grands groupes qui espéraient encore que ce serait un mauvais rêve et qu’on pourrait revenir au Minitel et au contrôle des flux. Les rares initiatives produits comme Mygale (premier hébergeur communautaire) ou Écho (moteur de recherche du niveau de Google dans les années 90) ont fini par disparaître.
Si on voulait bâtir, il fallait partir.
La Silicon Valley de cette époque était le paradis des informaticiens : on est bien avant les tech bros et les growth hackers, et Steve Jobs était encore dans la logique de construire un produit, pas de créer des écosystèmes fermés aux câbles incompatibles qu’il faut payer une fortune pour remplacer.

En France, c’était l’inverse : on détruisait Alcatel et Thomson, on licenciait les informaticiens, on expliquait dans les écoles d’ingénieurs que le monde n’en avait plus besoin et qu’il fallait se diriger vers le conseil ou les SSII. Les mêmes décideurs, encore en place aujourd’hui et qui ont participé à cette déconnexion technologique ont réussi grâce à une presse de connivence à faire éliminer toute trace de leurs responsabilités.
Revenir en France est compliqué quand on a vécu cela. Luc Julia a eu, lui, l’intelligence de rester aux US. En revenant, j’ai tenté d’expliquer ce que j’avais vu, ce que j’avais appris et comment construire des produits. Mon erreur a été de croire que l’on pouvait répliquer l’esprit de la Silicon Valley dans le système français.
J’ai essayé comme entrepreneur, mais aussi dans le cadre d’une mission gouvernementale. Aux États-Unis, les informaticiens sont considérés comme de véritables créateurs informatiques, à la fois bâtisseurs et artistes de la technologie. En France, on les traite comme des cols bleus du numérique.
Cette incompatibilité de vision était trop forte et le cabinet de Fleur Pellerin a tout fait pour que ma mission ne soit pas publiée, car elle contredisait le nouveau narratif officiel de la toute nouvelle “French Tech” dont l’objectif était de mettre en valeur non pas les startups mais les aides du gouvernement pour les startups. Un non-sens qui s’est traduit par le fait que les startups n’étaient pas l’objectif de la politique numérique mais leur variable d’ajustement.
Ce qui est curieux, c’est que Luc Julia, qui a créé une startup ORB (c’est à ce moment-là que je l’ai connu), a fait le choix de ne pas se positionner en entrepreneur mais en co-inventeur de Siri. Je ne sais pas si c’est un move de ses communicants (sa maison d’édition) ou s’il avait naturellement compris qu’il valait mieux rester sur une posture d’oracle pour parler d’IA et la critiquer sans être dans l’arène.
On peut lui reprocher de ne pas avoir “trop bossé sur ses présentations”, mais ce qui est sûr, c’est que Luc Julia n’est pas un charlatan (il y en a des vrais dans notre écosystème).
Ce que je trouve dommage, c’est son incapacité à défendre et promouvoir la vision de l’internet et de la tech des années 90 dans l’espoir d’inspirer une nouvelle génération. Mais il a peut-être simplement compris, plus lucidement que moi, que le système actuel ne le permet plus.
En France, deux visions cohabitent : la startup disruptive et culturelle de la Silicon Valley, et la startup “de la French Tech” adaptée aux codes locaux. Quand on regarde le nombre de Français talentueux partis se lancer au Y Combinator, on constate que l’écosystème national ne reconnaît toujours pas ses “créateurs informatiques”.
Aujourd’hui, faire de la tech en France dans l’esprit humaniste de la Silicon Valley des années 90 est devenu impossible ou presque. Le niveau de culture informatique est proche de zéro et la perpétuation des clichés sur le technofascisme supposé de la Silicon Valley nous absout d’une véritable réflexion sur les responsabilités de nos leaders et l’impossibilité pour des créateurs informatiques de bâtir les infrastructures alternatives dès les années 2000.
Le monopole de la Silicon Valley incarne avant tout la victoire des cyniques et d’une génération fascinée par le nouveau pouvoir que confèrent les positions monopolistiques. Dans sa version la plus business centrée, on retrouve la transformation d’Apple, qui a compris qu’un écosystème fermé maximisait la valeur extractible par utilisateur. Chez Palantir, Facebook ou Google, le monopole sert d’abord à renforcer leur contrôle sur les données, et à organiser la perpétuation de leur propre survie.
La culture humaniste a fait place aux tech bros et aux product managers des boîtes de tech qui choisissent leurs costumes pour Burning Man pendant que leurs équipes codent grâce à des copilotes IA. C’est possible car l’Europe est désormais la première contributrice à leur fortune.
À travers Cybernetica, je ne cultive pas la nostalgie de la Silicon Valley des années 90 : j’essaie plutôt de reconnecter cette vision humaniste à l’Europe. La question n’est pas celle de l’adaptation à la technologie : tout informaticien encore curieux sait naviguer entre les technologies et utiliser ce qui est à sa disposition, y compris le Vibe coding.
La question, c’est la finalité d’un produit : savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons, ce que nous devons faire, et surtout où nous devons nous restreindre.
Doug Engelbart (1925–2013) l’avait bien compris lorsqu’il parlait d’augmentation de notre intellect ; il reste l’un des véritables architectes d’une vision humaniste de la technologie. Mais c’est Marshall McLuhan (1911–1980), philosophe canadien des médias, qui avait le mieux résumé cet enjeu : “We shape our tools and therefore they shape us.”
C’était d’ailleurs sur cette phrase que je démarrais mon cours il y a 5 ans à Sciences Po sur les origines culturelles de la Silicon Valley. Il est peut-être temps de le relancer.
Passez de bonnes fins de vacances.